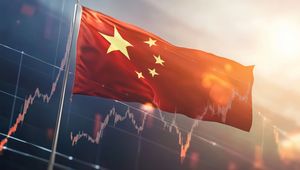Les études sont unanimes : la perte de la biodiversité est en passe d’atteindre un seuil critique. Aujourd’hui, environ 40 % de biodiversité a été perdue, que cela concerne des espèces menacées ou des espèces plus communes avec des conséquences non négligeables pour nos économies. La pérennité de secteurs entiers est menacée. Sous le poids de la réglementation, mais aussi grâce à la COP 15, les investisseurs et les gérants commencent à s’intéresser à cette thématique. S’ils souhaitent investir dans des solutions qui préservent la biodiversité, ils buttent sur un manque d’accès aux données et finalement sur un vivier d’entreprises spécialisées encore trop insuffisant. Ils appellent ainsi à une plus grande mobilisation des investisseurs, de la société civile et des pouvoirs publics afin d’inciter à la création d’entreprises porteuses de nouvelles solutions. Et les opportunités sont là. Selon le Forum économique mondial, les investissements relatifs à la biodiversité représentant un marché potentiel sont valorisés à 10 billions de dollars par an, et à près de 395 millions d’emplois à horizon 2030.
- La biodiversité est encore un thème assez nouveau pour la finance, quels sont les grands enjeux ?
- Emmanuelle Sée, responsable de la gestion actions, en charge de l’impact investing et de la thématique biodiversité de Swiss Life Asset Managers France
- Avez-vous l’impression que ces notions qui sont assez techniques sont comprises et déclenchent une réaction ?
- Isabelle Delattre, directrice du pôle finance responsable et durable de Crédit Mutuel Asset Management
- Les investisseurs doivent-ils prendre des engagements comme dans le cadre du climat ?
- Alvaro Ruiz-Navajas, gérant-analyste thématiques chez Tocqueville Finance
- N’est-il pas possible de concevoir un produit d’investissement entièrement tourné vers la problématique de la biodiversité ?
- Laurent Chaudeurge, responsable ESG et porte-parole de la gestion de BDL Capital Management
- Les difficultés méthodologiques proviennent-elles davantage des indicateurs ou de l’accès aux données ?
- Appliquez-vous une méthodologie à l’ensemble des portefeuilles ou à quelques secteurs clés ?
- Vous évoquiez précédemment le biais des fonds en faveur des petites et moyennes capitalisations, les stratégies biodiversité possèdent-elles également des biais pays ?
- Antoine Cadi, directeur recherche et innovation de CDC Biodiversité
- Est-il nécessaire de lancer un fonds sur cette thématique, celle-ci ne peut-elle être intégrée dans les fonds ESG ?
- Pour aller plus loin, ne faut-il pas aussi communiquer davantage auprès des investisseurs, des ménages ?
Avec, de gauche à droite :
- Alvaro Ruiz-Navajas, gérant-analyste thématiques chez Tocqueville Finance, filiale de la Banque Postale Asset Management
- Isabelle Delattre, directrice du pôle finance responsable et durable de du Crédit Mutuel Asset Management
- Antoine Cadi, directeur recherche innovation chez CDC Biodiversité
- Laurent Chaudeurge, responsable ESG chez BDL Capital Management
- Emmanuelle Sée, responsable de la gestion actions, en charge de l’impact investing et de la thématique biodiversité de Swiss Life Asset Managers France

La biodiversité est encore un thème assez nouveau pour la finance, quels sont les grands enjeux ?
Antoine Cadi, directeur recherche innovation chez CDC Biodiversité : La biodiversité peut se définir comme l’ensemble du vivant et va de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Tous les éléments de vie ou de biodiversité au sein des écosystèmes mettent à la disposition de l’homme, de l’économie, des services dits écosystémiques. La nature, lorsqu’elle est en bonne santé, est capable de nous fournir un nombre incalculable de services, comme la recharge des nappes phréatiques en passant par la pollinisation, la photosynthèse, etc. Notre capacité à nous alimenter, à vivre, mais aussi notre épanouissement personnel : tout dépend de la nature. Il est maintenant bien documenté qu’une part très importante du PIB mondial repose sur ces services gratuits fournis par la nature. Les spécialistes estiment que ces services représentent environ 55 % du PIB. Pourtant, aucune entreprise n’intègre dans son bilan comptable sa dépendance à ces services écosystémiques. Toutes les entreprises font reposer leur business model sur la disponibilité de la ressource, sans prendre en considération ce que va coûter leur remplacement par des solutions techniques ou par la réparation des dégradations.
La biodiversité se porte très mal. Le rythme d’extinction s’est accéléré : 90 % des effectifs de mammifères sauvages ont disparu au cours du siècle dernier. Aujourd’hui, nous sommes à environ 40 % de biodiversité perdue, que cela concerne des espèces menacées ou des espèces plus communes, et les conséquences pour nos économies ne sont pas négligeables. Si la dépendance à la nature est évidente pour certains secteurs d’activité comme l’agroalimentaire, cela est aussi le cas pour l’ensemble des secteurs d’activité. EDF par exemple a positionné ses centrales nucléaires le long de fleuves ou de cours d’eau dans des pays tempérés, l’entreprise il y a encore quelques années ne se posait pas la question de la disponibilité en eau (en volume et en température pour refroidir les réacteurs) ; aujourd’hui, cette dernière devient une source de préoccupation. Chaque année, EDF va en effet être dans l’obligation de stopper l’activité de certains réacteurs faute d’eau de refroidissement. Les exemples pourraient être multipliés. Nous commençons à bien cerner le risque climatique à travers les travaux du GIEC, des méthodes d’évaluation des émissions et une métrique unique, la tonne équivalent CO2. Si cette dernière peut sembler caricaturale, elle a au moins l’avantage de permettre une communication entre les acteurs économiques. En matière de biodiversité, il est urgent de suivre un même chemin, d’abord pour prendre pleinement la mesure de notre dépendance et des risques associés pour les entreprises et les individus, ensuite pour mettre en œuvre une démarche de réduction d’impact voire de tentative de restauration.
Isabelle Delattre,directrice du pôle finance responsable et durable de du Crédit Mutuel Asset Management : Quelques réflexions pour compléter ces propos. D’abord, il est important de souligner qu’il est impossible d’établir pour l’heure une comptabilité des services fournis par la nature. Par ailleurs, la transition climatique sur laquelle les gérants d’actifs ont déjà des pistes de réflexion avancées agit en interaction avec la biodiversité. L’humain est partie prenante du réchauffement climatique et de la dégradation de la biodiversité. La réglementation européenne a mis l’accent sur le réchauffement climatique, mais les pistes pour réduire l’impact de notre activité sur ce dernier ne sont pas toujours compatibles avec la protection de la biodiversité. Prenons pour preuve l’exemple des éoliennes. Quelles doivent être nos priorités dans ce cadre ? La transition climatique ou la lutte contre la perte de la biodiversité ? En tant qu’investisseur, nous devons nous poser ce type de questions, mais il n’est pas simple d’y répondre.
Alvaro Ruiz-Navajas, gérant-analyste thématiques chez Tocqueville Finance, filiale de la Banque Postale Asset Management : Il existe une grande différence entre la problématique de la biodiversité et celle du climat : la première est beaucoup plus locale que la seconde. Les émissions de carbone en Chine par exemple ont un impact sur l’ensemble de la planète. En revanche, les conséquences de la destruction de la biodiversité sont souvent locales, elles sont circonscrites à un pays voire à une région. Par ailleurs, il nous semble important de ne pas opposer le changement climatique et la préservation de la biodiversité. L’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) a démontré dans le cadre de ses travaux que le changement climatique faisait partie des cinq principaux facteurs ayant un impact négatif sur la biodiversité. Il ne faut pas arbitrer entre ces deux objectifs, ils vont de pair.
Laurent Chaudeurge, responsable ESG chez BDL Capital Management : Nous pouvons remarquer que les avancées les plus importantes obtenues ces dernières années l’ont été grâce à la réglementation. Or, celle-ci est bien plus conséquente en matière de lutte contre le réchauffement climatique que dans le cadre de la préservation de la biodiversité. Le risque associé à la multiplication de la réglementation est celui d’une « indigestion » qui limite les stratégies mises en œuvre par les entreprises. Ces dernières doivent déjà se mobiliser rapidement et massivement pour le climat, et peuvent être réticentes à s’engager aussi sur la biodiversité. Par conséquent, ce chantier risque de n’avancer qu’à petits pas, faute de réglementation et de mobilisation des acteurs économiques.
Isabelle Delattre : La réglementation européenne en matière de biodiversité est certes encore embryonnaire, mais l’Union européenne est en train de travailler sur de nouveaux textes. Il existe des textes sur la préservation de la forêt et sur le devoir de vigilance au niveau européen, mais il est vrai que les exigences des autorités européennes sont moins fortes en termes de biodiversité que de climat. Je vous rejoins aussi sur cette lassitude possible des entreprises en matière de réglementation.
Antoine Cadi : Ce point est très important. Le corps social doit accepter ces réglementations qui sont le moteur du changement. Les parties prenantes peuvent faire évoluer la réglementation, mais celle-ci doit être acceptée et cela d’autant plus que les demandes faites aux entreprises en matière d’indicateurs se multiplient. C’est pourquoi il faut prioriser les objectifs.
Emmanuelle Sée, responsable de la gestion actions, en charge de l’impact investing et de la thématique biodiversité de Swiss Life Asset Managers France : La prise de conscience de la dégradation de la biodiversité n’est pas nouvelle, mais pour autant les enjeux ne sont pas parfaitement intégrés. Connu sous le nom de sixième extinction de masse, le déclin alarmant de la biodiversité représente l’une des principales menaces à laquelle le monde doit faire face, selon le World Economic Forum (WEF). La plateforme intergouvernementale IPBES sur la biodiversité tire également la sonnette d’alarme. Parmi les facteurs principaux responsables de la dégradation de nos écosystèmes, nous retrouvons les changements d’utilisation des terres et des mers, l’exploitation directe des espèces, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. En matière de biodiversité, le mouvement de dégradation s’inscrit dans une dynamique avec des points de bascule où elle devient impossible à restaurer. Nous sommes selon certaines études proches du point de basculement, voire au niveau du point de basculement en Amazonie. Au-delà de l’intérêt pour les espèces et les écosystèmes, il s’agit de services écosystémiques, intégrant un prisme de régulation du climat. Nos écosystèmes jouent un rôle central dans l’absorption du carbone. Les océans et les écosystèmes terrestres absorbent, en effet, près de la moitié du CO2 émis globalement et contribuent directement à atténuer le réchauffement de la planète. La dégradation de la nature induit des répercussions sanitaires et sociales. La pérennité des modèles économiques et du système financier est elle aussi menacée. Il y a des conséquences directes sur les activités des entreprises et inévitablement sur leurs revenus. On estime que 5 à 8 % de la production agricole mondiale actuelle, représentant une valeur marchande annuelle de 235 à 577 milliards de dollars US, est directement attribuable à la pollinisation animale.
Emmanuelle Sée, responsable de la gestion actions, en charge de l’impact investing et de la thématique biodiversité de Swiss Life Asset Managers France

Connu sous le nom de sixième extinction de masse, le déclin alarmant de la biodiversité représente l’une des principales menaces à laquelle le monde doit faire face, selon le World Economic Forum (WEF).
Parcours
Emmanuelle Sée a pour mission d’accompagner le déploiement de la gamme actions, et notamment les trois fonds thématiques à impact : biodiversité, climat, green building et infrastructures. Elle dispose de plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs avec un parcours international. Emmanuelle Sée débute sa carrière chez Bank of China puis rejoint Amundi où elle évolue à différents postes de 2014 à 2021. Depuis 2021, elle était gérante actions thématiques globales chez CPR AM (Groupe Amundi), dédiée aux solutions impact, notamment climatiques et environnementales, avant de rejoindre Swiss Life AM en 2022. Diplômée d’un master spécialisé en finance, Emmanuelle Sée est également titulaire de deux licences, en chinois et en japonais, de l’Institut national des langues orientales (« Langues O »).
Données clés
- Effectifs dans l’expertise : 4
- Encours dans l’expertise et % des encours totaux : 108 millions d’euros sur un total de 5,6 milliards d’euros d’encours actions
- Historique de performance dans l’un des fonds phares : Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap (données au 28/02/2023) : performances cumulées YTD : 5,27 % et sur un an : – 0,29 %.
- Philosophie d’investissement en quelques mots : Chez Swiss Life Asset Managers, nous sommes convaincus que le respect de la biodiversité est la nouvelle thématique prioritaire des investisseurs engagés. Notre fonds thématique sur la biodiversité est géré de façon active et quantitative (quantamentale). Le prisme quantitatif permet de construire une structure de portefeuille solide en maîtrisant l’enveloppe de risques et de contraintes réglementaires. L’approche fondamentale est quant à elle essentielle pour sélectionner au mieux les valeurs.
Avez-vous l’impression que ces notions qui sont assez techniques sont comprises et déclenchent une réaction ?
Emmanuelle Sée : La prise de conscience est réelle. Les crises de la biodiversité et du climat sont conjointes. A première vue, il existe encore peu de solutions opérationnelles qui s’adressent à la problématique de la protection de la biodiversité, cependant, de nombreuses entreprises sont en train d’émerger aussi sur ce sujet. Un gisement est en train de se constituer et cela est positif. Le combat contre la perte en biodiversité représente un vivier d’opportunités, au sein duquel de nouvelles solutions et technologies émergent. Selon le WEF, les investissements relatifs à la biodiversité représentant un marché potentiel sont valorisés à 10 billions de dollars par an, et près de 395 millions d’emplois à horizon 2030. Les entreprises positionnées sur ce terrain constituent de réelles opportunités d’investissement, même si le gisement peut sembler plus limité que pour le climat. On retrouve ces entreprises sur toutes les zones géographiques. Tourné vers l’océan, le Japon compte ainsi plusieurs sociétés spécialisées dans la protection de l’écosystème marin. Riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles et menacées, l’Australie se distingue également avec ses entreprises dédiées à l’économie circulaire. En Europe et aux Etats-Unis, on trouve davantage de sociétés tournées vers la lutte contre la pollution à travers par exemple la préservation des écosystèmes terrestres ou en eau douce. Concrètement, certaines entreprises utilisent des solutions basées sur la nature pour améliorer leurs résultats financiers et d’autres valorisent les actifs naturels et les services écosystémiques pour orienter leurs propres décisions opérationnelles. Notre rôle en tant qu’investisseur est d’encourager ce mouvement en développant cette thématique, en finançant des entreprises.
Isabelle Delattre : La clientèle institutionnelle s’intéresse déjà à la problématique de la biodiversité en raison des obligations réglementaires, mais le grand public, tel que nous pouvons le côtoyer à travers nos réseaux bancaires, s’intéresse en premier lieu aux thématiques sociales et ensuite au climat dans le cadre de la durabilité. Les particuliers ne sont pas encore suffisamment sensibilisés à la problématique de la biodiversité. Une prise de conscience est nécessaire sur la nécessité de préserver afin de ne pas perdre l’effet mémoire de la biodiversité, fruit d’un historique par lequel le vivant s’est adapté.
Laurent Chaudeurge : En tant qu’experts, nous avons l’impression que le sujet est central mais il faut être réaliste, cette progression est insuffisante, nous avons besoin d’une accélération. Les feux qui dévastent des forêts sont davantage présentés comme la conséquence du réchauffement climatique sans que les dommages sur la biodiversité ne soient évoqués. Les forêts sont identifiées comme des puits de carbone plutôt que comme des réservoirs de biodiversité. De même, la montée des eaux est associée dans l’imaginaire du public au réchauffement climatique, mais les conséquences du réchauffement des océans sur la biodiversité sont méconnues. Et nous pourrions multiplier les exemples. Les actions de communication de la part des pouvoirs publics et/ou des organisations non gouvernementales (ONG) sur ce thème doivent être massives et plus visibles.
Antoine Cadi : Les problématiques du climat et de la biodiversité nous obligent à sortir des postures pour avancer rapidement, et ce quel que soit notre positionnement dans la chaîne de valeur. Investisseurs, entreprises, consommateurs, autorités : nous devons tous avancer dans le même sens. Nous sommes tous porteurs de solutions à différents niveaux, elles sont de plus en plus nombreuses, mais restent encore trop limitées. Les investisseurs disposent de peu d’options, d’entreprises qui apportent des solutions et dans lesquelles investir, même en renonçant à une partie des dividendes.
Emmanuelle Sée : Les solutions sont limitées, mais c’est le propre d’une thématique qui émerge. Nous pouvons dans un premier temps éviter les entreprises à impact négatif et en parallèle rechercher des sociétés avec un impact positif. Concrètement, nous pouvons exclure les entreprises à impact négatif, dont l’activité contribue directement à dégrader les écosystèmes marins et/ou terrestres. Ensuite, investir pour préserver la biodiversité consiste à choisir des entreprises qui proposent des solutions contribuant à réduire la pollution, à améliorer la qualité de l’eau ou à réduire la production de déchets, notamment par la prévention et le recyclage. Nous constatons une dynamique dans ce domaine, des initiatives positives. Nous avons aujourd’hui une assez bonne cartographie des impacts et dépendances des activités et des secteurs.
Antoine Cadi : Il est important de réduire l’impact négatif. En tant que fournisseur de données et d’analyse, nous travaillons notamment sur les pertes évitées. Mais il faut être humble, nous sommes face à un problème d’effondrement de la biodiversité, éviter et réduire l’impact ne sera pas suffisant. Nous devons faire émerger les business de demain qui n’existent pas encore, il faut aller chercher et former une nouvelle génération d’entrepreneurs qui puissent œuvrer à des solutions et/ou qui possèdent une autre approche de l’économie. L’émergence du local est également importante car il peut permettre une consommation plus responsable. Tous les codes doivent être redéfinis et constituer le socle d’une nouvelle économie qui protège et restaure. Il faut attribuer un coût ou un prix à la nature. Les concepts existent déjà, maintenant ils doivent être utilisés.
Isabelle Delattre, directrice du pôle finance responsable et durable de Crédit Mutuel Asset Management

La réglementation européenne a mis l’accent sur le réchauffement climatique, mais les pistes pour réduire l’impact de notre activité sur ce dernier ne sont pas toujours compatibles avec la protection de la biodiversité.
Parcours
Isabelle Delattre, diplômée de sciences économiques, a mesuré, dès 1998, l’importance de l’extra-financier dans l’analyse des entreprises. Analyste financier puis gérante de fonds internationaux pour une clientèle institutionnelle chez Fimagest, Isabelle a fondé avec trois associés Expertise Asset Management, la filiale française de United Asset Management, en 1997, en développant une approche de gestion enrichie par les notions de durabilité. Directrice générale de Raymond James AM dès 2005 où elle initie des travaux sur l’empreinte climat des portefeuilles, elle se consacre à partir de 2020 à l’ensemble des sujets touchant l’ESG au sein du Crédit Mutuel AM.
Données clés
- Effectifs dans l’expertise ESG : 10
- Philosophie d’investissement en quelques mots : La finance responsable et durable est devenue une partie intégrante de tous nos processus de gestion et désormais dans l’ensemble de notre gamme de fonds. Le groupe s’est fixé cinq objectifs en 2019 : redéfinir une politique d’investissement durable ; mettre à disposition des gérants un outil propriétaire d’analyse de données extra-financières ; renforcer la gamme de fonds ISR ; intégrer les critères extra-financiers dans l’ensemble des pratiques de gestion ; et étoffer les rapports de gestion. Tous ces objectifs ont été atteints et continuent à être renforcés. La société de gestion mène actuellement une réflexion sur l’approche fondamentale d’un fonds biodiversité. Cela étant, la biodiversité fait partie intégrante de son analyse qualitative des émetteurs. Elle devrait par ailleurs publier début juin un « white paper » sur la déforestation.
Les investisseurs doivent-ils prendre des engagements comme dans le cadre du climat ?
Isabelle Delattre : Il y a eu certes davantage de résolution pour le climat votées cette année lors des assemblées générales (AG), mais nous ne pouvons considérer que les engagements pris sont suffisants pour faire avancer la cause du climat. Un vernis se dépose, mais le diable est dans les détails. Quand un groupe d’hydrocarbures par exemple dépose une résolution climat, elle reste en deçà de nos exigences climatiques et la thématique biodiversité n’est même pas abordée.
Antoine Cadi : Les engagements sont absolument nécessaires à la lutte contre la crise de la biodiversité. Mais lorsqu’une entreprise prend des engagements en matière de biodiversité, encore faut-il qu’ils se situent à la hauteur des enjeux. Quand une entreprise réalise un bilan d’impact, elle peut alors comprendre l’ampleur de sa dépendance à la biodiversité et sa responsabilité dans le cadre de la dégradation de l’écosystème dans lequel elle s’insère. Elle prend alors conscience que placer une ruche sur son toit ou limiter l’utilisation de produits phytosanitaires est très loin d’être suffisant. L’impact se compte en milliards d’euros, en millions de kilomètres carrés annuellement détruits. Les chiffres réels sont conséquents et les entreprises ont déjà cumulé des dettes vis-à-vis de la nature. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de demi-engagements. Il était intéressant de voir, dans le cadre de la COP 15, que plusieurs centaines de grandes entreprises se sont engagées sur des objectifs significatifs ; il faudra suivre dans la durée l’évolution de ces engagements et les résultats obtenus.
Laurent Chaudeurge : Les engagements doivent être circonscrits à certains périmètres et chiffrés pour être crédibles car de cette façon, un suivi peut être assuré. Toutefois, ils butent sur un problème de standard, de chiffres comparables et opposables. Il n’existe pas de standards en matière de biodiversité à l’exemple de la tonne de carbone pour le climat. Dans cette optique, il sera intéressant de savoir si l’initiative Science-Based Targets en matière de biodiversité va être adoptée de façon large par l’industrie financière. En ce qui nous concerne, nous avons commencé nos travaux en nous appuyant sur le critère de l’eau : les prélèvements, la consommation, etc., en essayant d’observer si les entreprises mesurent leur consommation et si elles se donnent des objectifs dans ce domaine. Cette démarche est très concrète, mais elle ne traite qu’une petite partie du sujet, ce n’est qu’un début. Nous pouvons nous faire une idée de la partie de notre portefeuille qui est dépendante de l’eau dans son business model, quelles sont les entreprises parmi celles qui sont dépendantes qui publient des informations et qui traitent de ce sujet et se donnent des objectifs. Nous pouvons alors nous fixer des pistes d’engagement concrètes.
Isabelle Delattre : Nous travaillons sur la déforestation. Nous sommes en train de sourcer les pays, les secteurs, les zones et les critères à utiliser. Tous les éléments qui peuvent nous permettre de trouver de l’information, et si celle-ci n’est pas accessible, alors nous allons dialoguer avec les émetteurs afin de les sensibiliser à cette nécessité de communiquer sur leurs impacts. Nous constatons une amélioration dans ce domaine, les émetteurs commencent à communiquer. La réglementation les pousse à cela, mais aussi d’un point de vue sectoriel, il est important pour eux de conserver le leadership et la prise en compte de l’impact de leur activité peut y contribuer. La réputation d’un émetteur peut rapidement être entachée. Nous n’adressons pas l’ensemble des critères à ce stade et des secteurs, mais nous souhaitons progresser.
Alvaro Ruiz-Navajas, gérant-analyste thématiques chez Tocqueville Finance

Chaque fonds doit se donner un objectif. Pour nous, il semble important de ne pas mélanger les stratégies afin de pouvoir proposer aux investisseurs des stratégies complémentaires.
Parcours
Alvaro Ruiz-Navajas a 15 ans d’expérience. Il a démarré sa carrière comme consultant en développement de systèmes financiers chez GIZ, puis est devenu analyste chez Fortis Investments à partir de 2007. En 2009, il intègre l’équipe d’analystes de BNP Paribas avant de devenir gérant de portefeuille, spécialiste des secteurs énergie et utilities. Il a été en charge de deux fonds responsables, dont un axé sur la transition énergétique. Il entre en 2021 chez Tocqueville Finance Finance comme gérant-analyste thématiques. Il est titulaire d’un doctorat en économie à l’Université de Manchester.
Données clés
- Effectifs dans l’expertise : 3 gérants-analystes sur la gamme thématique environnement et 8 experts thématiques dans l’équipe ISR Solutions.
- Encours dans l’expertise et % des encours totaux : encours gamme thématique environnement (à fin avril 2023) : 1 033 M€, soit 11 % des encours gérés par Tocqueville Finance Finance, spécialiste des actions au sein de LBP AM.
- Historique de performances dans l’un des fonds phares : Conformément à la réglementation MIF, l’historique du fonds (inférieur à 1 an) ne permet pas d’afficher les performances et les indicateurs de risque du portefeuille.
- Philosophie d’investissement en quelques mots : La philosophie d’investissement de Tocqueville Finance Biodiversity ISR se décline selon quatre leviers : identifier des solutions aux enjeux de la biodiversité et du capital naturel, comme les entreprises œuvrant pour le traitement de l’eau ; exclure les secteurs qui exercent des pressions structurellement négatives sur la biodiversité et qui ne peuvent être corrigées comme les énergies fossiles et l’extraction minière ; une sélection best-in-class ; enfin l’engagement : la société de gestion accompagne les entreprises dans la mise en place de bonnes pratiques en s’engageant par exemple contre la déforestation ou en limitant l’utilisation du plastique.
N’est-il pas possible de concevoir un produit d’investissement entièrement tourné vers la problématique de la biodiversité ?
Antoine Cadi : Un produit dédié à la biodiversité aurait actuellement un impact réduit sur la dégradation de la biodiversité par rapport à un produit classique, mais cet impact ne sera pas nul. Il correspond ainsi à l’objectif IPBES de zéro perte nette. Cela n’est pas suffisant pour autant, et il faut encore s’attaquer au risque d’atteindre un seuil d’inéluctabilité ou de non-retour. Nous sommes déjà à la limite et devons trouver des réponses massives. Les véhicules d’investissement réduisent le risque, mais ne s’adressent pas réellement aux problématiques rencontrées. Il n’existe pas sur le marché de produits financiers véritablement dédiés à la restauration de la biodiversité. Il ne faut pas juste ralentir l’extinction des espèces, il faut la stopper voire restaurer des espèces. Pour atteindre cet objectif, nous connaissons la recette, il faut l’appliquer et s’engager, mais il faut surtout que des solutions émergent. Il y a encore trop d’inertie au sein des grandes entreprises, elles ne sont pas enclines à se transformer rapidement, à adopter de nouveaux modèles et les start-up sont de leur côté encore trop peu nombreuses. En parallèle, les grandes entreprises comme les investisseurs doivent revoir leurs attentes et s’adapter à un contexte où le capital naturel possède un prix.
Emmanuelle Sée : Des entreprises émergent et contribuent à apporter des solutions. Les fonds impact, y compris les fonds sur la thématique de la biodiversité, possèdent ainsi généralement un biais tourné vers les petites et moyennes capitalisations. J’aimerais insister dans ce cadre sur l’importance de l’analyse fondamentale. Il est essentiel d’analyser entreprise par entreprise la façon dont les critères de respect de la biodiversité sont réellement intégrés. Cela nécessite de comprendre fondamentalement les activités des entreprises et leur sensibilité vis-à-vis de la biodiversité. Nous ne pouvons pas nous limiter à une analyse quantitative.
Alvaro Ruiz-Navajas : Nous sommes au début du parcours pour comprendre la biodiversité en tant qu’investisseurs. Cette thématique est en retard de 15 à 20 ans par rapport au climat. Nous sommes encore en train de nous demander quelles actions pertinentes mener. C’est difficile pour les sociétés de revoir leur business model ou de faire des propositions nouvelles si par ailleurs nous ne sommes pas en mesure de calculer la contribution de la biodiversité à la croissance par exemple. Si une société peut réduire son impact par rapport au changement climatique, elle sait qu’elle doit réduire ses émissions de carbone. Mais pour la biodiversité, les actions à mener sont moins intuitives. Il faut expliquer, faire preuve de pédagogie. De même, aucun expert n’est d’accord sur le montant des services offerts par la nature. Comment proposer alors des solutions ?
Antoine Cadi : Qu’il s’agisse de la valeur de remplacement ou bien des services rendus, même si les écarts sont importants entre les experts en termes de chiffrage, nous avons une idée de ce que cela représente, les fourchettes basses généralement retenues étant peu crédibles. Autrement dit, la contribution de la nature au PIB est comprise entre 3 % et 4 % du PIB mondial. Cela nous donne suffisamment d’indications pour chercher des solutions.
Alvaro Ruiz-Navajas : Personne ne remet en cause le besoin de trouver des solutions. Mais, il faut parvenir à trouver la bonne méthode.
Antoine Cadi : La méthodologie et les métriques forment une problématique importante, mais pas mûre. Il existe différentes approches, nous ne savons pas encore laquelle va l’emporter. Chez CDC Biodiversité nous contribuons de façon active à cette réflexion et privilégions une approche à savoir le MSA au kilomètre carré, qui correspond à l’abondance moyenne des espèces et dont les valeurs varient de 0 % à 100 % (100 % représentant un écosystème vierge ou intact). Cette méthode dont nous ne sommes pas les inventeurs a été largement adoptée pour calculer l’empreinte d’un acteur sur la biodiversité, et elle nous a semblé être la plus pertinente. Nous incitons par ailleurs la communauté des chercheurs et des utilisateurs à se parler, à creuser de nouvelles pistes, à trouver même de nouvelles métriques car plus il y aura d’initiatives, plus nous pourrons avancer. Nous faisons aussi partie d’initiatives en Europe qui consistent à utiliser, sur la base d’un même échantillon, différentes métriques afin de les comparer et de les analyser. C’est une période de transition encore inconfortable car nous ne sommes pas encore certains de la pertinence des méthodes utilisées.
Pour autant, nous ne devons pas attendre de disposer de la bonne méthode pour agir. Nous n’en avons pas le temps. Entre l’artificialisation des sols, la déforestation et la raréfaction de certaines matières premières, nous disposons d’indicateurs qui sont adossés à des événements tangibles et qui s’emboîteront aisément. Aujourd’hui mesurer son empreinte biodiversité à l’échelle macro et ensuite essayer de construire une stratégie en se donnant comme objectif zéro déforestation, un label ou encore la réduction de la consommation d’eau, toutes ces approches sont possibles et positives. Il en va de même de l’émission de carbone : pour certains scientifiques, cette donnée est caricaturale, mais elle est pourtant utile. Dans 5 ou 10 ans, nous disposerons certainement d’une métrique partagée en matière de biodiversité ou même de plusieurs, l’important est que celles-ci s’appuient sur un socle conceptuel suffisamment robuste et qui permette d’avoir une bonne réactivité et de pouvoir prendre des décisions.
Laurent Chaudeurge : A ce stade, concevoir un produit entièrement tourné vers la biodiversité qui soit crédible me semble très difficile. Le nombre des sociétés cotées qui offre des « solutions » biodiversité est très faible et leur taille est souvent trop petite pour espérer développer un fonds à grande échelle. Si l’angle utilisé par la gestion consiste à sélectionner les sociétés qui réduisent leur impact sur la biodiversité, là encore, les gérants peuvent rencontrer des difficultés liées au manque de données. Trop peu de sociétés fournissent les informations nécessaires au calcul d’une empreinte biodiversité et la plupart d’entre elles ne divulguent pas non plus d’objectifs officiels d’amélioration.
Laurent Chaudeurge, responsable ESG et porte-parole de la gestion de BDL Capital Management

Les engagements doivent être circonscrits à certains périmètres et chiffrés pour être crédibles car de cette façon, un suivi peut être assuré.
Parcours
Collaborateur depuis 2018 et diplômé de l’ESCP et titulaire du CFA, Laurent Chaudeurge a commencé sa carrière chez Goldman Sachs à Londres en 1999. Il a ensuite rejoint Morgan Stanley à Paris où il rencontre Hughes Beuzelin et Thierry Dupont, co-fondateurs de BDL Capital Management. En 2009, il intègre Exane comme membre du comité exécutif et responsable des ventes de Exane BNP Paribas. En novembre 2018, il rejoint BDL Capital Management où il prend la responsabilité de la politique ESG.
Données clés
- Effectifs dans l’expertise (ESG) : 3
- Encours dans l’expertise et % des encours totaux : 5 % des encours sont labellisés ISR au sens de la réglementation. 112 millions d’euros d’encours dans le fonds BDL Transitions au 28/04/2023
- Historique de performance dans l’un des fonds phares : Performance YTD de BDL Transitions + 8,0 % (au 28/04/2023)
- Philosophie d’investissement en quelques mots : BDL Transitions, est un fonds Long Only ESG qui investit selon cinq thématiques : transition énergétique, transition digitale, transition mobilité et infrastructures, transition santé, et transition « nouvelle économie ». Ce fonds est labellisé investissement socialement responsable (ISR). La prise de conscience des défis sociétaux et environnementaux entraîne des changements de comportement qui poussent les entreprises à s’adapter. Cette « révolution ESG » crée des opportunités. Le fonds investit dans les entreprises qui sauront innover et se réinventer pour durer.
Les difficultés méthodologiques proviennent-elles davantage des indicateurs ou de l’accès aux données ?
Isabelle Delattre : Nous utilisons la métrique développée au sein de CDC Biodiversité. En revanche, il est vrai aussi que l’accès aux données constitue une vraie difficulté. Lorsque nous engageons un dialogue avec un émetteur sur sa spécificité métier, ses activités, nous comprenons mieux les enjeux. J’ai échangé par exemple avec un grand groupe dans le secteur du bâtiment. Ce dernier doit respecter un très grand nombre de normes sur les matériaux, l’impact sur l’environnement et les espèces présentes, avant de déterminer l’emplacement et de lancer les travaux. Des contraintes techniques importantes pèsent sur un grand nombre de secteurs d’activité et ceux-ci doivent être en capacité de nous fournir un grand nombre de données. Ces dernières ne sont cependant pas encore toutes organisées. Est-ce que toutes les entreprises comprennent véritablement les implications en termes de biodiversité sur l’ensemble de la chaîne de valeurs à laquelle elles contribuent ? Des poulets vendus en France, produits en France, s’inscrivent dans un cycle qui a démarré au Brésil ! Il faut détailler au cas par cas tous les impacts tout au long de la chaîne de valeur. Ce travail est complexe. Les entreprises doivent ainsi nous fournir davantage d’informations que dans le cadre du réchauffement climatique puisqu’elles se limitent dans ce cadre à la tonne de carbone. Nous avons besoin de données quantitatives et qualitatives adaptées à chaque secteur d’activité. Certains secteurs ne sont presque pas concernés ou de façon très indirecte par la biodiversité. Les secteurs ayant un impact direct sont l’agriculture et l’élevage, les mines ou plus généralement l’extraction de matières premières.
Laurent Chaudeurge : La problématique de la biodiversité est encore plus concentrée en termes de secteur que celle du climat, elle porte donc que sur une partie réduite des portefeuilles, tandis que les méthodologies sont plus compliquées. Cela freine l’effort, d’où le peu d’initiatives mises en œuvre par les gérants. Si je devais choisir un cheval de bataille, ce serait celui de réclamer quelques données clés auprès des entreprises.
Appliquez-vous une méthodologie à l’ensemble des portefeuilles ou à quelques secteurs clés ?
Alvaro Ruiz-Navajas : En ce qui nous concerne, notre premier chantier a été d’utiliser la base de données Encore qui analyse l’impact de chaque secteur ou sous-secteur sur la biodiversité, et à partir de là, nous avons choisi quelques secteurs ou sous-secteurs éligibles à notre univers d’investissement. Certains secteurs ne sont pas pertinents pour la biodiversité comme les logiciels ou la communication, d’autres sont fondamentalement négatifs pour la biodiversité comme l’extraction minière ou pétrolière. Notre univers d’investissement est de ce fait relativement restreint. Parmi celui-ci figure l’économie circulaire, les déchets, le recyclage, le traitement de l’eau ou encore l’agroalimentaire. Dans ce dernier secteur, il nous a semblé important dès le lancement de notre stratégie de développer une politique d’engagement. Ces sociétés peuvent conduire des initiatives intéressantes comme l’agriculture régénératrice, mais mènent-elles en parallèle suffisamment d’actions en matière de réduction des emballages ou pour contrôler leurs fournisseurs tout au long de la chaîne de valeur de leurs activités ?
L’objectif de notre fonds biodiversité est de limiter l’impact de l’activité humaine sur cette dernière. Il est impossible pour l’instant de prendre en compte l’impact positif, mais dès que cela sera possible, lorsque des solutions émergeront dans l’univers des actifs cotés, nous réorienterons notre process d’investissement. Ce fonds a été lancé avec l’idée de faire évoluer notre stratégie d’investissement au fur et à mesure que la thématique va gagner en maturité.
Laurent Chaudeurge : une méthodologie peut être appliquée à l’ensemble d’un portefeuille mais la réalité est qu’elle ne sera pertinente et matérielle financièrement que sur une partie limitée du portefeuille. C’est sur cette partie que, en tant qu’investisseurs actifs, nous devons exiger plus de transparence et plus d’objectifs de réduction du risque biodiversité de la part des entreprises. Pour obtenir des résultats, l’engagement doit être ciblé sur quelques émetteurs et aborder des sujets très précis et mesurables.
Vous évoquiez précédemment le biais des fonds en faveur des petites et moyennes capitalisations, les stratégies biodiversité possèdent-elles également des biais pays ?
Alvaro Ruiz-Navajas : Notre fonds est concentré sur les entreprises dont la capitalisation de marché est comprise entre 10 et 50 milliards d’euros et il est investi dans l’ensemble des marchés mondiaux. Actuellement, la répartition géographique est équilibrée entre les Etats-Unis et l’Europe, nous sommes aussi investis de façon plus marginale en Asie. Cependant, nous ne possédons aucune exposition en Amérique latine, malgré toute son importance pour la biodiversité. Il est difficile de trouver des sociétés qui publient des données sur le sujet et constituent un bon cas d’investissement.
Isabelle Delattre : Nous avons mené une étude au mois de janvier dernier sur les fonds existant sur le marché français. Il en existe une douzaine ayant dans leur dénomination le terme « biodiversité » ; neuf d’entre eux sont globaux, les trois autres sont européens. Les fonds globaux possèdent un biais en faveur des petites capitalisations boursières et sont souvent très exposés à l’Asie. Les sociétés sélectionnées en Asie par ces fonds s’inscrivent dans la recherche de solutions. Il existe aussi une autre catégorie de fonds qui investissent dans des sociétés qui ne dégradent pas la biodiversité, ces derniers étant concentrés sur quelques secteurs. Nous pouvons nous interroger sur le bien-fondé de ces fonds dans la mesure où ils n’investissent qu’au sein de secteurs non directement concernés par la biodiversité et ne recherchent pas d’émetteurs apportant des solutions.
Emmanuelle Sée : Pour revenir sur l’Asie, en effet, de nombreuses sociétés sont en train de se développer autour de ces problématiques. Prenons l’exemple du Japon, après la catastrophe de Fukushima, la société civile comme les autorités publiques ont pris conscience de la nécessité de préserver l’environnement. Parmi les sociétés qui se développent, elles sont nombreuses à chercher des solutions pour protéger l’écosystème maritime. Notre fonds possède ainsi un biais en faveur du Japon. Par ailleurs, il existe une dynamique autour de nouvelles solutions et cela se retrouve concrètement dans le dépôt des brevets. Concernant les fonds d’investissement, ils sont nombreux à se réclamer de la thématique de la biodiversité, mais d’après nous, ils ne devraient pas figurer dans cette catégorie. Il faut faire la différence entre les fonds biodiversité et les fonds investis sur le capital naturel (fonds forêt ou fonds eau par exemple) qui exploitent directement nos écosystèmes et ne cherchent pas à les préserver. Cette nuance est importante.
Antoine Cadi : Précisons par exemple qu’un fonds forêt repose sur l’exploitation de la filière bois. Idéalement les forêts exploitées réunissent des espèces qui poussent rapidement. Le sujet de la biodiversité considère la forêt dans toutes ses dimensions, pas seulement la fourniture de bois et la séquestration de carbone, mais la préservation de l’ensemble des espèces. Nous n’y sommes pas encore pour des raisons évidentes : tant que la nature continuera à nous fournir des services gratuits, nous ne serons pas prêts à en payer le prix.
Isabelle Delattre : Il existe encore peu de fonds biodiversité, leur historique de performance est limité, les tailles sont réduites en termes d’encours. Cela devrait changer lorsque nous disposerons d’une comptabilité extra-financière qui prendra en compte la valeur du capital naturel.
Emmanuelle Sée : La plupart des fonds biodiversité ont, en effet, été lancés l’an dernier dans la foulée de la COP 15. En ce qui nous concerne, notre fonds a été lancé au mois d’août 2021 et nous étions parmi les premiers.
Antoine Cadi : Cette situation changera lorsque les pénuries seront manifestes. Déjà en Chine ou aux Etats-Unis, les cultures fruitières manquent d’insectes pollinisateurs. En Chine, les minorités ouïgoures réalisent la pollinisation au pinceau, faute d’insectes. Aux Etats-Unis, la location de ruchers est devenue une activité courante à certaines périodes de l’année. Aujourd’hui, les arboriculteurs en Floride possèdent un nouveau poste de dépenses lié à ce type de location. Ils sont alors intéressés non pas par la restauration de l’écosystème et donc des insectes, mais par le coût de cette prestation et la façon dont ils peuvent la répercuter pour conserver leur marge. Toutefois si les problèmes de ce type se multiplient, les acteurs devront bien se préoccuper du long terme et de la restauration des écosystèmes. Ils vont devoir revoir leur modèle économique, diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires et replanter.
Laurent Chaudeurge : Cet exemple des ruches est intéressant car il montre bien qu’il existe un coût implicite à l’utilisation des écosystèmes. Les entreprises réagissent uniquement lorsqu’elles sont face à un problème business. Nous rencontrons maintenant le même problème en France en matière d’usage de l’eau. La consommation pouvant être tarifée, les entreprises commencent maintenant à réfléchir à la façon dont elles pourraient réduire leur consommation. Sur ces sujets en apparence extra-financiers, les entreprises agissent souvent davantage dans la réaction plutôt que dans l’anticipation.
Alain Cadi : Début mai en France, Vittel et Hépar ont annoncé la fermeture de plusieurs sources et vont devoir réduire leur production. A la différence des ruches, il n’y a pas d’alternatives pour les producteurs, la production va devoir décroître. Dans certaines situations, nous ne pourrons remplacer ou trouver des substituts à l’arrêt des services apportés par la nature, faute de solutions techniques ou parce que le coût est prohibitif.
Isabelle Delattre : En tant qu’investisseurs, nous avons un rôle à jouer pour changer les modèles économiques, par l’engagement et par la prise en compte d’une rentabilité de long terme qui doit s’appuyer sur une préservation de la ressource.
Alvaro Ruiz-Navajas : Les entreprises possèdent souvent une approche à court terme. Elles se projettent trimestre par trimestre à chaque publication de résultats, mais peu finalement sur le long terme, en particulier en dehors de l’Europe.
Antoine Cadi, directeur recherche et innovation de CDC Biodiversité

Nous devons faire émerger les business de demain qui n’existent pas encore, il faut aller chercher et former une nouvelle génération d’entrepreneurs qui puissent œuvrer à des solutions et/ou qui possèdent une autre approche de l’économie.
Parcours
Antoine Cadi est directeur recherche et innovation de CDC Biodiversité depuis mars 2017. Docteur en écologie, il a réalisé ses études à l’Université Lyon 1 et y a soutenu en 2003 une thèse sur les stratégies de conservation de la cistude d’Europe. En 2004, il devient le premier salarié de la toute jeune association Noé Conservation, et en développe l’équipe et les projets de conservation de la biodiversité en France et à l’international. En 2007, il rejoint la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme. Puis en 2009, à la demande du ministre, il rejoint le cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat en charge de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, en tant que conseiller technique biodiversité et forêt, et prépare, entre autres, les engagements de la France pour 2010, Année internationale de la biodiversité. Parallèlement, il devient conseiller scientifique du Fonds de dotation pour la biodiversité. Il est recruté par la LPO en septembre 2010, d’abord en tant que conseiller d’Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO France, puis en tant que directeur relations extérieures, communication et partenariats.
CDC Biodiversité
Créée en 2008 avec pour objectif de concilier biodiversité et développement économique, cette filiale du groupe CDC intervient sur trois axes : conseiller, mesurer et renaturer. CDC Biodiversité met en œuvre des actions concrètes et de long terme en faveur de la biodiversité, en développant des solutions innovantes et adaptées aux besoins des acteurs publics et privés. Son expertise lui permet de conseiller et de former à toutes les thématiques biodiversité. Elle est ainsi agréée organisme de formation depuis 2015. Afin de mesurer l’empreinte des activités économiques sur la biodiversité, CDC Biodiversité a développé un outil destiné aux entreprises et aux institutions financières et, à terme, aux collectivités territoriales. CDC Biodiversité met aussi en œuvre des actions concrètes de renaturation sur le long terme, qui visent la création de gains écologiques quantifiés par des solutions fondées sur la nature. Enfin, elle mène des partenariats étroits avec les acteurs du territoire, qui s’inscrivent dans l’engagement du groupe CDC pour la transition écologique.
Est-il nécessaire de lancer un fonds sur cette thématique, celle-ci ne peut-elle être intégrée dans les fonds ESG ?
Isabelle Delattre : En effet, un fonds ESG doit donner son empreinte carbone, la trajectoire en termes de température, et il doit prendre en compte la biodiversité.
Emmanuelle Sée : C’est exact, cependant, les deux thématiques peuvent parfois s’opposer. Reprenons l’exemple déjà cité des éoliennes dont l’impact négatif sur la biodiversité a été démontré. Nous pouvons rajouter également l’exemple de l’ammoniac vert, même s’il est produit de façon « propre », il aura toujours un impact négatif dans son utilisation finale, dans l’agriculture notamment. Pour résoudre ce type de contradictions, nous devons nous appuyer sur une analyse fondamentale des valeurs.
Alvaro Ruiz-Navajas : Chaque fonds doit se donner un objectif. Pour nous, il semble important de ne pas mélanger les stratégies afin de pouvoir proposer aux investisseurs des stratégies complémentaires. L’investisseur devant choisir lui-même quel est l’équilibre optimal entre les stratégies. Nous nous intéressons aussi à des fonds investis sur la thématique du capital naturel et qui mènent des actions intéressantes en faveur de la biodiversité.
Laurent Chaudeurge : L’intégration de la biodiversité dans un fonds ESG ou dans un fonds thématique sur le climat par exemple est tout à fait pertinente. Si des sociétés possèdent des business models viables qui contribuent à la restauration de la biodiversité, il n’y a pas de raison de ne pas les intégrer dans des fonds généralistes qui mettent la finance durable au centre de leur objectif de gestion. Cela peut donner naissance à une poche biodiversité au sein du fonds. De même, le changement climatique étant identifié comme étant la troisième cause de la perte de biodiversité, tous les fonds climat qui cherchent à réduire l’empreinte carbone de leurs investissements contribuent à réduire la dégradation de la biodiversité. Climat et biodiversité ne doivent pas être opposés, ils sont les deux enjeux clés d’une conscience environnementale éclairée.
Pour aller plus loin, ne faut-il pas aussi communiquer davantage auprès des investisseurs, des ménages ?
Antoine Cadi : La meilleure pédagogie est celle qui consiste à expliquer concrètement les enjeux : la perte de la biodiversité, les conséquences sur nos écosystèmes, sur nos modes de vie. Nous avons tous partie liée, nous devons ensemble trouver des solutions. Lorsque nous échangeons avec les différentes équipes de notre groupe : de l’investisseur à l’actionnaire jusqu’à l’entreprise, la chaîne doit être continue. Chaque maillon doit y contribuer, fournir les informations nécessaires. Et il ne s’agit pas seulement de collecter des informations afin de répondre à des objectifs réglementaires : il faut surtout en mesurer le sens et l’intérêt.
Isabelle Delattre : Pour finir sur une note positive : la nouvelle génération est plus attentionnée vis-à-vis de la biodiversité, plus à l’écoute de ce type de problèmes et plus intéressée. Nous voyons bien cela au niveau de notre clientèle : les épargnants les plus jeunes veulent que leurs investissements aient un sens. Il faut garder cet espoir. La COP participe aussi à une plus grande connaissance du sujet.
Emmanuelle Sée : La COP 15 sur la biodiversité, qui s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022, à Montréal, était très attendue après des annulations successives dues à la Covid. L’ambition politique était de reproduire pour la biodiversité l’effet mobilisateur de la COP 21 qui avait débouché sur l’Accord de Paris. 196 pays se sont réunis autour de cet objectif commun et, après plusieurs mois de négociations intenses, ont adopté un accord que l’on peut considérer comme historique. Cet accord définit un cap clair et fixe des objectifs quantifiés et mesurables pour réduire significativement la perte de la biodiversité. Elle a permis de réunir le secteur public et le secteur privé pour avancer dans la même direction. Le rôle de la réglementation est aussi déterminant, elle permet d’encourager voire de contraindre les entreprises à adopter une nouvelle démarche. L’intérêt des investisseurs pour la thématique de la biodiversité est encouragé, au niveau européen, par la réglementation SFDR. En France, la préservation de la biodiversité n’est pas oubliée dans la loi Energie-climat. Ainsi, l’article 29 de cette loi, qui pose de nouvelles exigences en matière de reporting extra-financier pour les investisseurs, stipule bien que les risques liés à la biodiversité doivent être pris en compte et que les stratégies d’investissement doivent être alignées avec les objectifs de long terme relatifs à la biodiversité. Par ailleurs, la directive CSRD, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2024, va constituer un progrès important, grâce à l’harmonisation des données extra-financières publiées par les entreprises européennes. Pour améliorer leur compréhension des enjeux, les investisseurs sont aussi incités à se tourner vers des fournisseurs d’informations différents, comme les ONG qui sont souvent plus expérimentées, plus spécialisées sur les questions de biodiversité que les agences de notation extra-financière traditionnelles. Ces progrès réglementaires, qu’ils s’inscrivent à l’échelle nationale ou européenne, associés à une prise de conscience plus grande du public et des épargnants pour ces questions, doivent maintenant se traduire concrètement en actes d’investissement.